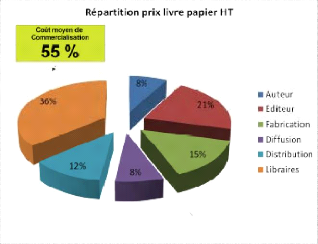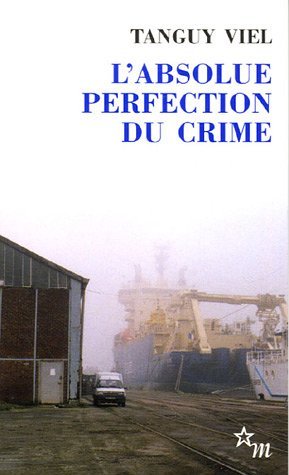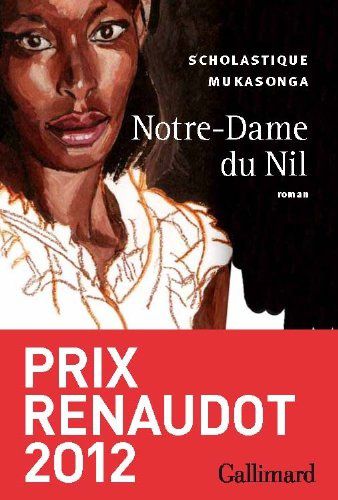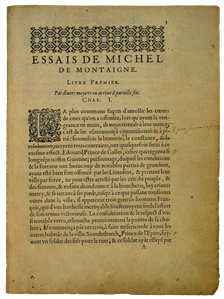[...]. C'était sublime. C'était impensable, impossible, grotesque. Aller dans un pays de mort avec un nez de clown, rassembler dix peuples sans savoir qui est qui. Retrancher un soldat dans chaque camp pour jouer à la paix. Faire monter cette armée sur scène. La diriger comme on mène un ballet. Demander à Créon, acteur chrétien, de condamner à mort Antigone, actrice palestinienne. Proposer à un chiite d'être le page d'un maronite. Tout cela n'avait aucun sens. Je lui ai dit qu'elle avait raison. Ses remarques étaient justes. La guerre était folie ? Sam disait que la paix devait l'être aussi. Il fallait proposer l'inconcevable. Monter Antigone sur une ligne de feu allait prendre les combats de court. Ce serait tellement beau que les fusils se baisseraient.
— Pour une heure, a ricané Aurore.
Elle était assise. je me suis accroupi entre ses genoux.
— Une heure de paix ? Et tu voudrais que nous rations ça ?
Voilà le défi que se donne Georges le narrateur du roman Le quatrième mur de Sorj Chalandon, représenter l'Antigone d'Anouilh à Beyrouth, théâtre du futur massacre de Sabra et Chatila, afin de respecter le vœu de Samuel Akounis, l'ami malade, le militant juif grec admiré. Le jeune Georges y arrive en 1982, juste avant le massacre de septembre. Là-bas, c'est le Liban qui tire sur le Liban, lui dit son chauffeur.

Une fois n'est pas coutume, je ne suis arrivé qu'au tiers des 325 pages du roman en vous proposant ce compte-rendu. Je ne devrais d'ailleurs pas faire une estimation en pages : j'écoute la brillante version audio – durée 9h10 – (le Grasset papier sur le côté) qui m'a été gracieusement envoyée par Audiolib dans le cadre de l'opération Masse critique de Babelio, merci à eux.

La lecture de Feodor Atkine, qui s'attèle seul à reproduire intensément les dialogues, est irréprochable. La présentation et le découpage en tranches d'un gros quart d'heure sont bien conçus. L'ensemble est complété par un entretien de trente minutes avec Chalandon où il explique qu'il a voulu, par ce roman, «faire sortir» la blessure de plus de vingt années de reportage de guerre. Intact physiquement, il porte en lui quelque chose qui est de l'ordre de la barbarie ou de la mort, qu'il a tenu à éclairer par ce livre.
À propos du récit, que je ne connais donc encore que partiellement, je conseille de visiter les pages de Textes&Prétextes qui en font une compte-rendu juste et complet et dont la conclusion salue un roman terrible où les illusions se fracassent.

Lors de l'occupation allemande, Jean Anouilh a voulu réécrire et représenter Antigone avec la consonance de la tragédie qu'il vivait. Nous en vivons une autre aujourd'hui au Proche-Orient, qui se ravive à Gaza. Quel théâtre faudra-t-il tenter d'y jouer...?
L
ors de l'occupation allemande, Jean Anouilh a voulu réécrire et représenter Antigone avec la consonnance de la tragédie qu'il vivait. Nous en vivons une autre aujourd'hui au proche-orient, qui se ravive dans la bande de Gaza.
Le roman porte en lui un aria mémorable dont Sorj Chalandon apprécie certainement l'interprétation de Cécilia Bartoli. Offrons au Proche-Orient embrasé un moment pacifié sans tirs ni canons, sans mur peut-être, en écoutant cette interprétation du même Piu Jesu que Sam Akounis voulait entendre lorsque les gardes emporteraient Antigone...