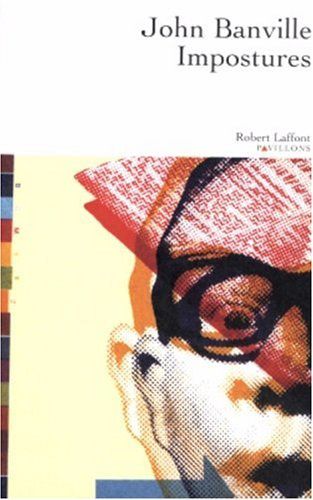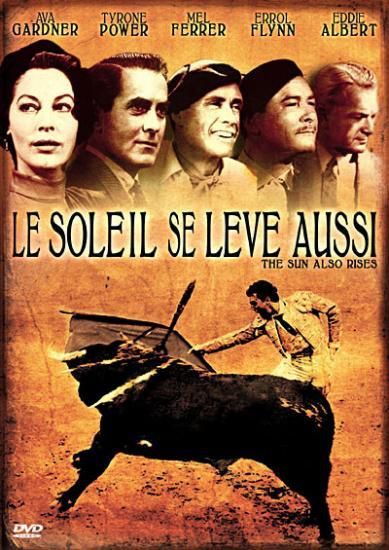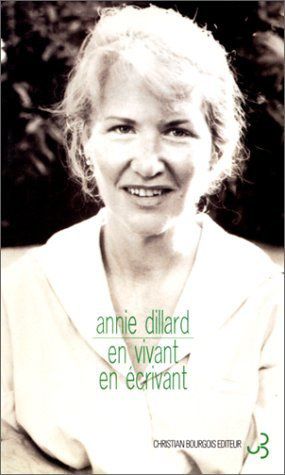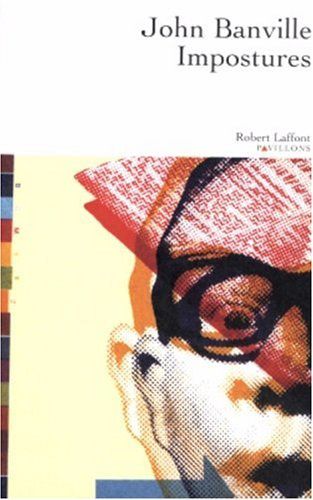
On a parfois l'impression que depuis près de 30 ans, John Banville a publié un seul et long roman. (The New Yorker)
Les fictions de l'auteur irlandais dégagent une atmosphère trouble, empreinte d'une sensualité fébrile à laquelle une froideur, qui
frise parfois le cynisme, confère une amertume lancinante. L'homme, ce narrateur confident habituel chez Banville, n'en reste pas moins d'une humanité saisissante.
Vieil universitaire alcoolique et capricieux, renommé pour ses écrits philosophiques, Axel Vander vit en Californie (Arcadie) et est
un imposteur. Durant la seconde guerre, porté par les événements, sans en comprendre alors ses motivations, il a usurpé l'identité d'un ami disparu, auteur d'articles sympathisant avec les thèses
nazies, ami dont il n'avait ni la formation, ni les origines bourgeoises. Lui-même est juif et sa famille a été déportée: J'ai longtemps nourri l'espoir qu'ils n'auront pas souffert à la fin, ni eux ni les autres, mais, depuis, j'en sais davantage sur
l'espoir. Une lettre d'une inconnue, Cass Cleave, l'avertit qu'elle connaît sa supercherie. Cette femme perturbée, atteinte d'hallucinations, au comportement bizarre (elle
souffre d'un trouble à voisin de la maniaco-dépression) et qu'il décide de rencontrer à Turin lors d'un
colloque, devient sa maîtresse. Il en tombe amoureux sans qu'elle n'ait encore révélé ce qu'elle sait de lui. À cet
endroit du roman, le lecteur éprouve l'impression de vivre un thriller psychologique. Banville n'a pourtant pas l'ambition de suspendre le souffle du lecteur, bien que la progression lente
maintienne la tension du récit jusqu'à son terme.

J. Banville
Illustration de Delphine Lebourgeois
Il s'agit avant tout d'un livre sur l'authenticité du moi. Axel Vander a assuré sa renommée de philosophe universitaire par ses
publications sur l'impossibilité de définir le moi fluctuant, au point d'en conclure qu'il n'existe pas. Une telle opinion posée, l'homme qui usurpe une identité, son épouse (Magda, peronnage
admirablement croqué) absente à elle-même dans ses derniers jours, une maîtresse habitée par des voix, tout concourt à réfléchir sur la réalité du moi. Et l'auteur multiplie les situations qui interpellent le narrateur sur
cette thématique:
...j'eus la sensation, [...], d'avoir laissé quelque chose de moi, me fis la réflexion que si je me retournais
maintenant, je surprendrais, affalée sur le siège que je venais de quitter, une grossière parodie de moi-même, marionnette grandeur nature, aux mains pendantes et aux membres tordus, décochant un
sourire impavide au plafond.
Une image esquissée me vint à l'esprit - de Bosch peut-être, ou de Dante ? - d'une silhouette émaciée,
voûtée et nue, courant la bouche béante et les bras levés à travers un paysage de terre rouge brûlante avec, attachée après elle, une autre silhouette, son double, en un solide dos à
dos.
Il sommeille en mon for intérieur un autre moi qui, en de tels moments, s'éveille en sursaut, surpris par
tout ce qui se passe, toute cette vie, son invraissemblance.
On note que la narration se déroule aux première et troisième personnes, ajoutant à la confusion de l'identité. Mais
qui, sinon vraiment lui, s'éprend de Cass Cleave au point d'être hanté par elle ? Les deux derniers mots du roman sonnent
fort: Elle. Elle. Existe-t-on davantage à travers l'autre ? …elle représentait ma dernière chance d'être moi. Rédemption par l'amour.
Il serait long d'exposer ici toutes les composantes de ce récit à l'intrigue dépouillée mais au débit dense et copieux. Trop peut-être pour adhérer à la présentation de Robert Laffont, qui y voit le roman le plus abouti de l'auteur.
(La mer et Infinis édités plus tard semblent
plus homogènes). Banville aime manifestement écrire et ne s'en prive pas: il abonde en séquences suggestives loin d'être essentielles à la trame centrale, telles les multiples aventures galantes
du narrateur. Le style est somptueux et on ne voudrait pas se priver de ces digressions magnifiques, à un niveau d'élégance dont la prose de l'irlandais n'est jamais dénuée. En cela, il convient
de saluer la traduction française de Michèle Albaret-Maatsch.
La mythologie et la peinture servent beaucoup les livres de John Banville: ainsi l'intéressante comparaison de Cassy
Cleave, alors qu'elle se dévoile, à la
remarquable Venus de Chranac (précisément celle du musée des Beaux-Arts de Bruxelles, le peintre ayant réalisé plusieurs versions du sujet): La ressemblance entre la femme peinte et celle-ci, vivante, venait de
m'apparaître, elle avait le même type onduleux, les mêmes hanches marquées ainsi que cette paleur un tantinet compassée.

On apprend sur Internet que Banville s'est inspiré, pour élaborer son personnage, de noms connus: le philosophe
Louis Althusser, assassin de son épouse, qui termina sa vie en hôpîtal psychiatrique et l'universitaire d'origine belge Paul de Man,
auteur d'articles antisémites durant la guerre.
Un livre un peu belge, plusieurs situations à Anvers, Liège et même un bref séjour au fond de l'Ardenne.
Enfin, l'ombre de Nietzsche plane sur Turin où il séjourna et vécut une dépression marquante. En épigraphe, Banville donne ce mot du philosophe: Au point où
commence notre ignorance et au-delà duquel nous ne voyons plus, nous plaçons un mot: par exemple, le mot «moi», le mot «faire», le mot «souffrir»; ce sont peut-être les lignes d'horizon de notre connaissance, ce ne sont
pas des «vérités». (Nietzsche, La volonté de puissance)